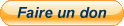LE CINÉMA AU MAROC, UNE ÉPOPÉE NATIONALE ET UN RAYONNEMENT MONDIAL
- il y a 5 jours
- 3 min de lecture

Le cinéma au Maroc est une histoire d’ancrage et d’ouverture, une aventure nationale portée par des institutions pionnières, des créateurs ambitieux et une vision royale qui a fait du Royaume une terre de tournage et de talent. Né très tôt à l’échelle régionale, le cadre réglementaire s’organise avec la création du Centre cinématographique marocain (CCM) par dahir du 8 janvier 1944, faisant du Maroc l’un des premiers pays d’Afrique du Nord à se doter d’un organisme public de régulation, de soutien et de rayonnement du 7ᵉ art. Après l’Indépendance, l’institution change d’échelle, accompagne la profession, structure l’exploitation, la formation et l’accueil des tournages internationaux, tandis que les premières salles—de Casablanca à Rabat—deviennent des lieux de sociabilité et de modernité.
Sur le plan créatif, la naissance du long métrage marocain s’impose à la fin des années 1950 avec Le Fils maudit de Mohamed Ousfour (1958), jalon qui annonce une génération de cinéastes soucieux d’écrire une grammaire esthétique propre. Les années 1970 voient émerger un corpus exigeant avec Wechma (Hamid Bennani, 1970), le regard d’auteur de Moumen Smihi, la veine critique et la production ambitieuse de Souheil Ben Barka. Le cinéma marocain y gagne un visage : populaire et d’auteur, enraciné et universel.
Au tournant des années 2000, l’essor se confirme : Maryam Touzani place la sensibilité marocaine sur les écrans du monde (Adam, Cannes 2019 ; Le Bleu du Caftan, Prix FIPRESCI Un Certain Regard 2022 et film marocain shortlisté aux Oscars). Dans la même dynamique, Faouzi Bensaïdi, Narjiss Nejjar, Daoud Aoulad-Syad, Farida Benlyazid, Hicham Lasri, Hakim Belabbes, ou encore Ahmed El Maânouni (documentaire Transes), élargissent la palette du récit national : urbain ou rural, intime ou politique, toujours habité par la dignité, la mémoire et l’espérance.
Ce mouvement créatif s’appuie sur une politique de festivals qui irrigue le pays et forge des passerelles : le Festival International du Film de Marrakech (créé en 2001 à l’initiative de SM le Roi Mohammed VI) est devenu l’un des rendez-vous majeurs de la région, vitrine d’exigence et de diversité ; le Festival National du Film à Tanger, grande messe du cinéma marocain ; le Festival du cinéma africain de Khouribga (1977), creuset continental et fierté du Maroc cinéphile. Parallèlement, les Atlas Workshops du FIFM accompagnent l’écriture et la coproduction, consolidant un écosystème qui attire talents et investisseurs.
La dimension internationale du Maroc-cinéma s’illustre aussi par la puissance de ses décors et de ses studios. Ouarzazate, “Hollywood d’Afrique”, avec l’Atlas et le CLA Studios, a accueilli Gladiator, Kingdom of Heaven, La Momie, des épisodes de Game of Thrones, Babel, Prince of Persia, Spectre (James Bond) ou encore des séquences d’Inception à Tanger. Ce succès tient autant à l’expertise locale (chefs déco, figurants, techniciens), qu’aux incitations pilotées par le CCM et à la stabilité du Royaume qui sécurise les productions. L’image du Maroc voyage ainsi à l’écran, associant paysages, patrimoine et savoir-faire.
L’infrastructure suit : après une décennie de repli des salles, le pays repart de l’avant. Les rapports du CCM signalent la digitalisation, les rénovations et une progression récente du nombre d’écrans, portée par de nouveaux complexes et la revitalisation d’adresses mythiques. Le box-office national retrouve des couleurs, alors que l’éducation à l’image, les ciné-clubs, les cinémathèques (Tanger, Rabat) et les politiques publiques d’aide à l’exploitation reconnectent les publics, notamment les jeunes. La consommation a changé—télévision et plateformes ont bousculé les habitudes—mais l’expérience de la salle, la convivialité et le “voir-ensemble” restent des marqueurs forts, parfaitement compatibles avec l’exigence morale d’une société attachée à ses valeurs.
Côté mentalités, le public marocain aime le cinéma quand il parle vrai et quand il rassemble : comédies sociales, grandes fresques historiques, portraits féminins courageux, épopées sportives, récits de dignité et d’élévation. La ligne est claire : créer sans renier son identité, s’ouvrir sans s’abîmer, rester fidèle à la Nation et à la Monarchie. C’est cette cohérence qui permet à des œuvres sensibles d’atteindre Cannes, Venise ou Berlin tout en restant profondément marocaines. Le cinéma est ainsi devenu un vecteur de soft power : il renforce la visibilité internationale du Maroc, attire des tournages, stimule le tourisme, transmet notre histoire, nos accents, nos musiques et nos langues, et donne aux jeunes la preuve qu’un horizon créatif de haut niveau existe au pays.
Enfin, si l’on devait retenir quelques repères pour une cinémathèque idéale : Le Fils maudit (Ousfour) ; Wechma (Bennani) ; Les Mille et une mains (Ben Barka) ; Badis (Tazi) et À la recherche du mari de ma femme ; Alyam, Alyam et Transes (El Maânouni) ; WWW – What a Wonderful World (Bensaïdi) ; Adam et Le Bleu du Caftan (Touzani) ; Ali Zaoua et Les Chevaux de Dieu (Ayouch). Ces films, par leur diversité, composent un récit : celui d’un Maroc sûr de lui, moderne et fidèle à ses valeurs, qui fait du 7ᵉ art une fenêtre sur le monde et un miroir de sa souveraineté culturelle.