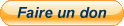LA DYNASTIE IDRISSIDE
- Brahim Al Maghribi
- 20 mai 2025
- 5 min de lecture

La dynastie idrisside, souvent célébrée comme la première dynastie chérifienne du Maroc, marque le début d’une longue lignée de dynasties ayant façonné l’histoire du royaume. Fondatrice de l’État marocain, elle fascine encore historiens, politiques et descendants des chorfas idrissides. Pourtant, son histoire, en partie voilée par le manque de sources contemporaines et enjolivée par des chroniques comme le Rawd al-Qirtās d’Ibn Abī Zar‘, reste énigmatique. Cet article explore l’ascension des Idrissides, leur rôle dans l’islamisation de l'Afrique du Nord, la fondation de Fès et les défis qui ont conduit à leur déclin, tout en nuançant les récits idéalisés pour mieux comprendre leur legs.
L’histoire des Idrissides commence dans un Afrique du Nord tumultueux, après les conquêtes arabes éphémères de ‘Oqba ibn Nāfi‘ (680-682) et Mūsa ibn Nusayr. Ces campagnes, bien que glorifiées par les textes orientaux, n’ont pas durablement islamisé la région. En 740, la révolte kharijite détacha l'Afrique du Nord du califat omeyyade, préservant l’islam sans l’enraciner profondément parmi les Amazighs, tandis que des sectes hérétiques, comme les Barghwata, persistaient. C’est dans ce contexte qu’Idris ibn ‘Abdullāh, connu sous le nom d’Idris I, descendant de ‘Ali par Hassan ibn Hassan, arriva au Maroc vers 788, fuyant les Abbassides après la bataille de Fakh.
Les sources, souvent postérieures, comme celles d’Ibn al-Faqīh al-Hamadāni (Kitāb al-Buldān, IXe siècle) ou d’al-Bekri (Al-Massālik, XIe siècle), soulignent son ascendance chérifienne et de la famille du Prophète Muhammad ﷺ. Accompagné de Rashīd, un fidèle énigmatique, Idris I gagna la confiance de la puissante tribu amazighe des ‘Awraba à Oualili, recevant leurbaï‘a (serment d’allégeance). Son prestige chérifien lui permit de rallier d’autres tribus, comme les Zénètes, les Zouagha et les Zwawa, posant les fondations d’une dynastie arabe et chérifienne. Bien que zaydite à l’origine, une branche modérée du chiisme, Idris I adopta le malékisme, alors en expansion au Maroc, facilitant son intégration parmi les populations locales.
Idris I s’employa à consolider son autorité en attirant des émigrés andalous et kairouanais pour peupler sa capitale naissante, équilibrant ainsi la démographie entre Arabes et Amazighs. Il lança des campagnes pour islamiser le Moyen Atlas (bilad Fazaz) et les forteresses des Ghiata dans l’Oriental, comme le rapporte leRawd al-Qirtās. Malgré la brièveté de son règne, interrompu par son assassinat par les Abbassides en 793, Idris I laissa un embryon d’État. Son épouse Kenza, probablement d’origine berbère (peut-être des ‘Awraba ou des Nafza), donna naissance à son fils, Idris II, quelques mois après sa mort. Ce lien matrimonial symbolisa l’union arabo-berbère, un thème central dans l’historiographie marocaine.
La régence de Rashīd, peu documentée, assura la transition jusqu’à ce qu’Idris II, âgé d’à peine onze ans, reçoive labaï‘a en 803. Son règne, selon la tradition, fut marqué par des avancées décisives dans l’islamisation et l’organisation de l’État, bien que certains récits aient été idéalisés par des chroniqueurs postérieurs.
Idris II est crédité de la fondation de Fès en 808, bien que des historiens modernes, comme L. Provençal et G. Colin, attribuent à Idris I la création d’un noyau initial sur la rive droite. Idris II développa la rive gauche (‘Adwat al-Qarawiyyine), faisant de Fès la capitale politique et spirituelle de son royaume. Il accueillit des milliers de familles d’Ifriqiya et d’Andalousie, notamment de Cordoue, pour diversifier la population et renforcer l’influence arabe. Sous son règne, Fès devint un centre administratif avec sixdiwāns gérant les ministères, la justice, les impôts, l’armée, le secrétariat et la frappe de monnaies, selon Ibn Sahl ar-Rāzi.
Idris II étendit son territoire par des conquêtes, reprenant Tlemcen, consolidant Nafis et Aghmāt dans le sud, et organisant les prélèvements fiscaux et la répartition des métiers. Ces efforts posèrent les bases d’un État structuré, bien que rudimentaire. À sa mort en 828, il laissa un royaume pacifié, malgré la menace persistante des Barghwata dans le Tamesna. Cependant, les rivalités avec les Omeyyades d’Andalousie et les pressions internes fragilisèrent l’unité de la dynastie.
Après la mort d’Idris II, sa mère Kenza conseilla à son petit-fils Mohamed, successeur désigné, de partager le royaume entre ses frères pour maintenir la cohésion. Mohamed conserva Fès et Oualili comme centre du royaume, tandis que ses frères reçurent des provinces : al-Qassim au nord (Tanger, Sebta), ‘Omar dans les Ghmara, Yahyā à Larache ou Tadla, Hamza au Zerhoun et Tlemcen, ‘Issa à Salé, Ahmed à Meknès et au Tadla, Dawūd chez les Hawara et Miknassa, et ‘Abdullāh à Aghmāt et Nafis. Ce partage, loin de renforcer l’État, précipita sa fragmentation. Les princes, agissant comme des gouverneurs autonomes (oualis), entrèrent en concurrence, affaiblissant l’autorité centrale.
Les sources, comme celles d’al-Bekri et d’Ibn Abī Zar‘, manquent de détails sur ces princes, hormis ceux de Fès, tels Mohamed, Yahyā I, Yahyā II, Ali ibn ‘Omar et Yahyā III. Les récits deviennent flous, et l’histoire des autres branches reste obscure. La construction de la mosquée Qarawiyyine, attribuée à Fatima al-Fihrya dans le Rawd al-Qirtās, est datée sous le règne de Daoud ibn Idriss par une inscription découverte dans les années 1960, illustrant les débats historiographiques sur cette période. Les historiens locaux réconcilient ces versions en suggérant que Fatima al-Fihrya construisit la mosquée sous l’égide de Daoud.
La dispersion du pouvoir et les rivalités internes rendirent la dynastie vulnérable. Les Omeyyades d’Andalousie et les Fatimides, voisins ambitieux, interférèrent dans les affaires idrissides. En 918, Fès fut prise par les kharijites Madiouna, puis par les Fatimides sous Mçala ibn Habbūs al-Miknassi. La dynastie s’effondra définitivement en 925, lorsque Mūsa ibn Abī al-‘Afiya, chef des Zénètes Miknassa, lança une campagne d’extermination contre les Idrissides. Cette persécution ne cessa qu’après l’intercession des chefs tribaux, permettant aux chorfas idrissides de se fondre dans les tribus, souvent en dissimulant leur ascendance.
Malgré leur chute, les Idrissides conservèrent un prestige intact grâce à leur origine chérifienne. Leur influence perdura à travers les grands pôles mystiques, comme Moulay ‘Abdeslam ibn Machich et son disciple ash-Shadily, et leur mausolée à Fès reste un symbole de leur grandeur passée. Les chorfas idrissides, tapis dans l’ombre, guettèrent des opportunités pour reprendre le pouvoir, notamment à la fin des Mérinides, tout en influençant la vie spirituelle et politique du Maroc.
La dynastie idrisside, bien que mal documentée, a jeté les bases de l’État marocain par son œuvre d’islamisation, la fondation de Fès et l’établissement d’une administration embryonnaire. Malgré les récits idéalisés du Rawd al-Qirtās et les incertitudes historiques, Idris I et Idris II ont uni Arabes et Amazighs sous une bannière chérifienne, laissant un héritage durable. Leur déclin, précipité par la fragmentation et les pressions externes, n’a pas effacé leur prestige, qui continue d’inspirer le Maroc contemporain. La dynastie idrisside demeure un jalon essentiel, non seulement comme fondatrice de l’État, mais comme symbole de l’unité spirituelle et culturelle du royaume.