LA MÉMOIRE DES TABORS MAROCAINS
- Brahim Al Maghribi

- 28 juil. 2025
- 3 min de lecture

Le mot « Tabor » trouve ses origines dans le berbère « Ṭabor » (طابور), signifiant « colonne », « détachement » ou « compagnie ». Cette appellation a été adoptée dans le lexique militaire colonial français pour désigner des unités composées de soldats marocains, organisées sous commandement français. Formées à partir des années 1930, les Tabors étaient structurés autour de trois Goums, des unités d’environ 200 à 250 hommes, dirigées par des officiers français, assistés parfois d’officiers marocains. Mais l’histoire des Tabors remonte plus loin, jusqu’à la création des premiers Goums marocains en 1908, dans le contexte de l’implantation militaire française au Maroc.
En 1934, la structure des Tabors s’institutionnalise davantage : les goumiers marocains sont intégrés dans des formations régulières de l’armée coloniale française. Cette organisation prend une ampleur considérable durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les autorités françaises, qu’elles soient de Vichy, de la France libre ou de la France libérée, mobilisent massivement ces unités. Les Tabors marocains se distinguent dans des théâtres d’opérations parmi les plus durs de la guerre : la campagne de Tunisie, le débarquement en Sicile et en Italie en 1943, le débarquement de Provence en août 1944, puis la campagne de France dans les Vosges et en Alsace. Après la guerre, leur engagement ne s’arrête pas : plusieurs Tabors sont envoyés en Indochine entre 1947 et 1954, dans ce qui devient l’un des conflits les plus sanglants de la décolonisation. D'autres participent à la résistance algérienne, certains anciens goumiers servant jusqu’à la fin du Protectorat.
Mais c’est précisément ici que la lecture de leur histoire requiert patriotisme, lucidité et sens des nuances. Les Tabors ne relevaient pas de l’armée marocaine indépendante, mais de l’armée coloniale française. Leurs membres n’étaient pas des soldats d’un Maroc souverain, mais des hommes engagés dans des unités façonnées par une puissance étrangère. Leur enrôlement obéissait à des logiques multiples : motivations économiques, fidélités tribales envers des caïds alliés à la France, ou encore simple pragmatisme dans un pays sous domination. Pourtant, il serait injuste et historiquement faux de les considérer comme des traîtres à leur patrie. Ces combattants ont, dans de nombreuses circonstances, fait preuve d’un courage exceptionnel. En Italie, les goumiers marocains sont restés gravés dans la mémoire locale pour avoir libéré des villages entiers sous le feu ennemi. Leur bravoure, leur endurance et leur efficacité au combat étaient saluées même par leurs adversaires.
Cela étant, l’exploitation de ces soldats par la machine coloniale française interroge profondément. Ils ont été utilisés pour des objectifs qui n’étaient ni les leurs, ni ceux de leur peuple : réprimer d’autres peuples colonisés, servir dans des guerres étrangères aux intérêts du Maroc, et maintenir une domination impériale que notre Histoire rejette désormais. Faut-il dès lors voir les Tabors comme un héritage honteux ou glorieux ? La réponse est délicate, mais elle n’est certainement pas honteuse. Ces hommes ont combattu avec honneur, parfois en protégeant des civils, et leur mémoire mérite d’être distinguée du système colonial qui les encadrait. Le Maroc d’aujourd’hui reconnaît, à juste titre, les sacrifices et les exploits individuels de ces soldats. Leurs descendants font partie intégrante du tissu patriotique national, et plusieurs sont aujourd’hui liés aux institutions militaires ou honorés par l’armée royale.
Ce qui demeure problématique, en revanche, c’est le cadre politique dans lequel ils furent déployés. Car aussi valeureux soient-ils, les Tabors n’étaient pas les instruments d’une nation libre, mais ceux d’une domination étrangère. En cela, leur histoire nous impose un devoir de mémoire exigeant : honorer la bravoure des hommes, tout en dénonçant l’injustice du système qui les a enrôlés. Le Tabor est donc un mot chargé, un symbole complexe où se croisent loyauté, exploitation, héroïsme et colonisation. Et c’est en assumant pleinement cette complexité que l’on rend justice à notre Histoire.


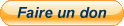



Commentaires