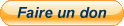COMPRENDRE LE SYSTÈME POLITIQUE MAROCAIN, ENTRE STABILITÉ ET CONTINUITÉ
- louel3arabiya

- 19 nov. 2025
- 8 min de lecture

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle où la légitimité du pouvoir repose à la fois sur la souveraineté du peuple et sur l’autorité du Roi. Ce système, consacré par la Constitution de 2011, établit un équilibre entre institutions élues et institutions royales, garantissant la stabilité politique et la continuité de l’État. Le Roi est à la fois Chef de l’État, Commandeur des croyants et arbitre suprême des institutions. Il veille au respect de la Constitution, oriente les grandes politiques nationales et nomme les hauts responsables civils, militaires et diplomatiques. Il préside le Conseil des ministres, conduit la politique étrangère et définit les grandes orientations économiques, sociales et religieuses. Le Roi dispose également du droit de grâce et peut adresser des messages au Parlement ou renvoyer une loi pour nouvelle lecture.
Le Chef du Gouvernement est désigné par le Roi parmi les membres du parti arrivé en tête des élections législatives. Il dirige l’action du gouvernement, coordonne les ministères, prépare le budget de l’État et applique le programme présenté au Parlement. Le Roi conserve toutefois la supervision directe des ministères régaliens : Intérieur, Affaires étrangères, Défense et Finances.
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement bicaméral composé de deux chambres :
La Chambre des représentants, avec ses 395 députés, est élue au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Elle représente les citoyens et vote les lois. Mais elle ne se contente pas de voter : elle peut aussi proposer des lois. Au Maroc, le droit d’initiative législative appartient à la fois au gouvernement (projets de loi) et aux parlementaires (propositions de loi). Les projets de loi émanent du Chef du Gouvernement ou d’un ministre et sont déposés en priorité à la Chambre des représentants. Les propositions de loi viennent des députés ou des conseillers et sont examinées selon la même procédure.
Les débats et votes se tiennent au siège du Parlement, à Rabat. Les séances plénières sont publiques, retransmises en direct sur les chaînes parlementaires et publiées sur le site officiel du Parlement marocain (www.chambredesrepresentants.ma). Les votes se font soit à main levée, soit par appel nominal, et de plus en plus souvent électroniquement, via le système installé dans l’hémicycle. Les résultats des votes, le texte des lois adoptées et le nom des députés ayant voté pour, contre ou s’étant abstenus sont consultables en ligne sur les sites des deux Chambres. Le processus est donc public et traçable, sauf pour les séances à huis clos imposées par raison d’État (sécurité nationale, défense, etc.).
La Chambre des conseillers, elle, est élue au suffrage indirect pour un mandat de six ans. Ses 120 membres ne sont pas choisis directement par les électeurs, mais par différents collèges électoraux représentant les forces vives du pays :
– les élus des collectivités territoriales (communes, provinces et régions)
– les représentants des chambres professionnelles (commerce, agriculture, artisanat, pêche, industrie et services)
– les délégués des organisations syndicales les plus représentatives.
Ce système assure la représentation des territoires, des acteurs économiques et des salariés, donnant à la deuxième chambre une fonction d’équilibre et de concertation entre les différentes composantes du pays.
Les conseillers ne se contentent pas d’émettre des avis : eux aussi examinent, modifient et votent les lois. Le texte adopté par la Chambre des représentants leur est transmis pour deuxième lecture. En cas de désaccord, la Chambre des représentants a le dernier mot. Les conseillers ont donc un rôle de filtre, d’amendement et de perfectionnement législatif, notamment sur les questions économiques, sociales et territoriales. Ils peuvent également interpeller le gouvernement, comme les députés, et déposer des propositions de loi.
Le pouvoir judiciaire, proclamé indépendant par la Constitution, est garanti par le Roi, qui préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ce conseil veille à l’autonomie des magistrats et à l’application équitable du droit.
Pour voter, il faut être citoyen marocain, âgé d’au moins 18 ans, inscrit sur les listes électorales et jouissant de ses droits civiques. L’inscription peut se faire directement à la commune du lieu de résidence au Maroc, en ligne sur listeselectorales.ma, ou, pour les Marocains Résidant à l’Etranger, auprès des consulats du Royaume. Chaque année, le registre électoral est révisé afin de permettre aux nouveaux électeurs de s’inscrire et de corriger les informations erronées.
Pour être candidat, il faut également être inscrit sur ces listes et ne pas exercer une fonction incompatible avec un mandat public. Sont incompatibles : les membres des Forces Armées Royales, les magistrats, les walis et gouverneurs, les agents d’autorité (pachas, caïds), les ambassadeurs, les présidents de région, les directeurs d’établissements publics ou d’entreprises nationales, et plus généralement toute fonction comportant l’exercice d’une autorité au nom de l’État. Ces restrictions garantissent la neutralité de l’administration et l’indépendance du pouvoir politique.
Le Roi et les membres de la famille royale ne participent pas aux élections : ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. Leur rôle est constitutionnel, au-dessus du jeu partisan. Le Roi incarne la continuité de l’État et l’unité du peuple, sans jamais intervenir dans la compétition électorale. Historiquement, sous le règne de Feu SM Hassan 2, Allahi rahmo, le Souverain pouvait cumuler des fonctions exécutives il a été Premier ministre de 1961 à 1963 – mais cette possibilité a disparu avec l’évolution institutionnelle du pays. La Constitution de 2011, notamment à travers ses articles 41, 42 et 47, définit désormais le rôle du Roi comme arbitre suprême entre les institutions, garant de la continuité de l’État et nommant le Chef du Gouvernement. Il n’exerce plus le pouvoir exécutif au sens strict, mais veille, oriente et arbitre, laissant la conduite du gouvernement au Chef du Gouvernement issu des urnes.
Les élections législatives utilisent un scrutin proportionnel à listes : les électeurs votent pour un parti, et les sièges sont répartis selon le pourcentage de voix obtenues dans chaque circonscription. Ce mode de scrutin favorise la diversité politique et oblige les partis à former des coalitions. Ce n’est donc pas un système majoritaire où un seul parti gouverne seul, mais un système de partage et de compromis. Le paysage politique marocain est pluraliste. Chaque formation représente un courant historique ou idéologique précis, mais toutes reconnaissent l’autorité de la monarchie comme fondement de l’unité nationale. On distingue les grands partis, présents dans la plupart des gouvernements, et une série de petits partis dont le poids électoral reste limité, mais qui enrichissent le débat démocratique.
Le Parti de l’Istiqlal (PI), créé en 1944, symbolise le nationalisme historique. Conservateur et social, il défend la souveraineté nationale, la justice économique et la protection des classes moyennes. Parmi ses figures marquantes : Allal El Fassi, Abbas El Fassi et Nizar Baraka. Le parti se situe au centre droit et prône un État fort dans un cadre monarchique. Il milite pour une politique économique nationale, la taxation progressive (principe selon lequel plus le revenu est élevé, plus le taux d’imposition augmente), une éducation publique renforcée, et la création d’emplois stables. En diplomatie, il soutient fermement la marocanité du Sahara et le rôle moteur du Maroc en Afrique. Sur le plan religieux, il défend le rite malikite et l’autorité spirituelle du Roi.
Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), né dans les années 1970, incarne le libéralisme pragmatique et la modernisation économique. Actuellement dirigé par Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement, le RNI prône l’efficacité administrative, la réduction des inégalités régionales et la généralisation de la couverture médicale. Son action se concentre sur la santé, l’éducation numérique, l’investissement privé et la stabilité budgétaire. Sur le plan extérieur, il accompagne la diplomatie royale en Afrique et au Moyen-Orient, et soutient l’attractivité du Maroc pour les investisseurs.
Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), fondé en 2008, se veut le parti de la réforme politique et de la gouvernance moderne. Il plaide pour un État fort, rationnel et efficace, et se positionne comme un contrepoids aux partis religieux. Son courant est centriste et social-libéral. Sous la direction d’Abdellatif Ouahbi, le PAM défend la décentralisation, la transparence et la lutte contre la corruption. En matière sociale, il met en avant la prévention en santé, la réforme de l’école publique, et la simplification de la justice. En économie, il soutient une fiscalité équitable et la digitalisation de l’administration.
Le Parti de la Justice et du Développement (PJD), d’inspiration islamiste modérée, met l’accent sur la moralisation de la vie publique, la transparence et les valeurs sociales. Il a dirigé le gouvernement de 2011 à 2021 avant d’être largement battu. Dirigé historiquement par Abdelilah Benkirane et Saad Dine El Otmani, il se revendique du conservatisme moral et d’une gestion sobre des finances publiques. Il soutient un État protecteur mais non interventionniste, la rigueur budgétaire, la lutte contre la corruption, la priorité à la langue arabe dans l’enseignement, et une politique étrangère alignée sur la diplomatie royale tout en défendant les causes du monde musulman.
Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), héritier du mouvement communiste marocain, défend une gauche réformiste axée sur la justice sociale et la redistribution. Ses grandes figures sont Ali Yata, Ismaïl Alaoui et Nabil Benabdallah. Le PPS plaide pour l’école publique gratuite, la santé universelle et la protection du monde rural. Il prône un rôle fort de l’État dans la régulation économique et la lutte contre les inégalités.
L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), issue du courant progressiste des années 1960, prône la social-démocratie, la gouvernance démocratique et la protection des libertés publiques. Ses figures historiques, Abderrahim Bouabid et Abderrahmane Youssoufi, ont marqué la transition démocratique. L’USFP milite pour la parité hommes-femmes, la réforme du service public, la formation universitaire et la redistribution équitable des richesses.
Le Mouvement Populaire (MP), centré sur la défense du monde rural et de la culture amazighe, soutient la décentralisation et la cohésion territoriale. Il a été fondé par Mahjoubi Aherdane et Mohand Laenser. Son orientation est conservatrice et nationaliste. Il défend l’enseignement de la langue amazighe, l’amélioration des services publics dans les zones rurales et la préservation de l’unité territoriale.
L’Union Constitutionnelle (UC), fondée par Maati Bouabid, représente un libéralisme modéré, favorable à l’économie de marché et à la stabilité politique. Elle soutient les réformes économiques, la simplification des procédures administratives et la modernisation du droit du travail.
À côté de ces grandes formations, le Maroc compte plusieurs petits partis, tels que le Parti Socialiste Unifié (PSU), le Front des Forces Démocratiques (FFD), le Mouvement Démocratique et Social (MDS), le Parti de la Renaissance et de la Vertu (PRV) ou encore le Parti Vert Marocain, axé sur l’écologie. Leur influence parlementaire reste faible, mais ils participent au pluralisme politique et animent le débat démocratique sur des thèmes spécifiques (libertés individuelles, environnement, économie locale, valeurs religieuses, etc.).
Ces partis se répartissent en quatre grands courants :
– le courant libéral et monarchique (RNI, PAM, UC)
– le courant national et conservateur (Istiqlal, MP)
– le courant social et progressiste (USFP, PPS)
– le courant islamiste modéré (PJD).
Tous reconnaissent la monarchie comme le pilier central du système politique marocain. Les débats se concentrent donc sur les politiques publiques, les priorités économiques et les questions sociales plutôt que sur la légitimité du régime.
Une fois les lois votées par le Parlement, elles sont soumises au Roi pour promulgation. La promulgation est l’acte par lequel le Souverain confirme officiellement la loi adoptée et ordonne sa publication. Cette publication se fait au Bulletin Officiel du Royaume du Maroc, seule version juridiquement opposable. C’est à partir de cette publication que la loi entre en vigueur, selon la date fixée dans son texte ou, à défaut, trente jours après sa publication. Ce mécanisme garantit que chaque texte législatif ait force obligatoire, tout en assurant la transparence et la traçabilité du processus.
Le modèle marocain repose sur une complémentarité : la monarchie fixe les orientations et garantit la stabilité, tandis que les institutions élues assurent la gestion et la représentation. Ce système a permis au Royaume de progresser sans rupture, de réformer sans désordre et de maintenir la cohésion nationale dans un contexte mondial instable. La politique marocaine s’appuie sur la réforme continue, la concertation et l’équilibre, dans le respect de l’identité du Royaume et de son héritage historique.