COMMÉMORATION DU 50ᵉ ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE
- Brahim Al Maghribi

- 6 nov. 2025
- 4 min de lecture

« Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d’Afrique et qui respire grâce à son feuillage bruissant aux vents de l’Europe. » Ces mots de feue SM le Roi Hassan II résument une conception profonde de l’identité nationale marocaine et expliquent pourquoi le recouvrement du Sahara a été et demeure une cause non négociable.
Le 16 décembre 1965, l’Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 2072 relative à la « Question d’Ifni et du Sahara espagnol », invitant l’Espagne à mettre fin à sa présence coloniale sur ces territoires et à engager des négociations avec le Maroc, alors que n’existait pas encore d’autre revendication organisée et reconnue sur ces territoires. (Archives ONU ; voir notices relatives à la décolonisation).
En 1968 et avant l’apparition officielle du Front POLISARIO en 1973 (création du mouvement séparatiste, mais il existait bien avant en tant que mouvement sahraoui de libération contre l’Espagne, dans la continuité du combat national marocain), des mouvements et mobilisations nationalistes se manifestèrent dans le Sahara espagnol. Le Mouvement de Libération de Seguia el-Hamra et Rio de Oro, lié au mouvement nationaliste dirigé par Sidi Brahim Bassiri, témoigne de cette phase initiale du combat anticolonial dans la région ; des familles et archives locales confirment que Bassiri était avant tout nationaliste et non le fondateur d’une logique séparatiste telle qu’elle sera ultérieurement revendiquée. (Témoignages archives locales ; travaux historiques sur la région).
Après des négociations intermittentes, l’Espagne accepta de céder Sidi Ifni via le Traité de Fès du 4 janvier 1969, tout en refusant, dans un premier temps, de reconnaître la marocanité du Sahara et en évoquant l’éventualité d’un référendum qui ne se tiendra jamais. La question du statut final du territoire resta donc ouverte et source de tensions. (Archives diplomatiques, presse d’époque).
Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de Justice rendit un avis consultatif sur le Sahara occidental. La Cour reconnut l’existence de liens juridiques d’allégeance et d’affiliation entre certaines tribus sahariennes et le Sultan du Maroc, tout en concluant que ces liens ne suffisaient pas à établir l’existence d’un titre souverain immédiat exclusif. L’avis est complexe mais il constitue une étape juridique majeure qui participe du contexte diplomatique de la fin 1975.
C’est dans ce climat que fut organisée la Marche Verte, le 6 novembre 1975. Convaincu que la cause saharienne relevait de l’unité et de la souveraineté nationale, SM Hassan II mobilisa des centaines de milliers de Marocains, hommes et femmes, qui, drapeaux à la main et Coran guidant leur marche, manifestèrent pacifiquement et massivement leur attachement au Sahara marocain. Les images et les récits de l’époque décrivent un puissant élan populaire, sans effusion de sang, et qui contraignit l’Espagne à reconnaître la réalité politique de la revendication marocaine.
L’impact diplomatique fut rapide : le 14 novembre 1975, l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie signèrent à Madrid la Déclaration de principes (les « Accords de Madrid »), organisant le retrait de l’administration espagnole et une administration intérimaire conjointe. Cette Déclaration fut enregistrée officiellement auprès des Nations unies (enregistrement déposé le 9 décembre 1975). Les Accords prévoient des modalités temporaires et marquent la fin formelle de l’administration coloniale espagnole.
Face au fait accompli et aux mobilisations populaires massives, l’Espagne prit la décision politique d’éviter la confrontation armée avec des civils désarmés et signa l’accord tripartite. Le fait que l’Espagne ait, dans la foulée, déclaré mettre définitivement fin à sa présence au Sahara (26 février 1976 notification à l’ONU) éteint la thèse d’une prétendue persistance d’un statut colonial espagnol aujourd’hui. (Déclarations officielles espagnoles et registres de l’ONU).
La Marche Verte fut prévue avec une grande discrétion et préparée sur plusieurs mois. Le plan logistique et la confidentialité de l’opération sont attestés par les témoignages et les archives d’État : convocation de responsables militaires, planification du transport, approvisionnement, encadrement médical et sanitaire. Le dispositif comprenait des trains, des camions et des équipes médicales, afin d’assurer l’acheminement et la sécurité des volontaires. Des bilans chiffrés de l’époque font état d’une mobilisation de l’ordre de plusieurs centaines de milliers de volontaires (le chiffre rappelé dans la mémoire collective est souvent avancé à 350 000).
Dans ses discours préparatoires, SM Hassan II expliqua la portée pacifique et patriotique de l’action et mit en garde les volontaires contre les dangers potentiels (zones minées, obstacles militaires). Le 26 octobre 1975, en présence du Secrétaire général de l’ONU Kurt Waldheim, le Roi inaugura le grand barrage Al Massira, symbole d’un développement national intégré au projet territorial. Le transit des volontaires vers le sud mobilisa trains, camions et ressources : l’organisation logistique fut considérable (transport de vivres, d’eau, encadrement médical et présence des Forces Armées Royales en accompagnement).
La marche, qui s’étendit sur plusieurs jours, se déroula essentiellement de façon pacifique : hommes et femmes, certains portant le Coran et le drapeau national, rejoignirent les territoires du sud pour signifier la volonté populaire de rattachement. La participation féminine, notable (estimée à environ 10 % dans certains récits), souligne le caractère national et familial de l’élan populaire.
Le 18 novembre 1975, les Cortes espagnoles votèrent la loi sur la décolonisation du Sahara, et, en février 1976, l’administration espagnole se retira formellement. La suite des événements (installation d’un gouvernement intérimaire, affrontements armés entre Polisario et forces mauritaniennes/marocaines, implication régionale de l’Algérie et des conflits d’influence) montrera que la question ne trouva pas de règlement définitif immédiat : elle engagea des décennies de diplomatie, de médiation et d’opérations militaires et civiles.
Le Secrétaire général de l’ONU nomma ensuite un Représentant personnel pour la question du Sahara (Olof Rydbeck) chargé d’examiner les conditions en vue d’un processus politique, mission qui se déroula dans un contexte régional complexe et parfois conflictuelle. Les documents des Nations unies et les comptes rendus historiques permettent de suivre ces missions et leurs recommandations.
La Marche Verte est à la fois un acte populaire massif et une manœuvre d’État d’une rare acuité politique. Elle illustre la capacité d’une nation à conjuguer mobilisation populaire, pression diplomatique et stratégie d’État pour défendre une revendication territoriale jugée vitale. L’opération montre aussi la place centrale d’un chef d’État capable d’articuler légitimité historique, sens stratégique et organisation matérielle.
Cinquante ans après, la commémoration de la Marche Verte doit servir non seulement à honorer la mémoire des volontaires et la vision de Feu SM le roi Hassan II, mais aussi à rappeler l’importance du dialogue diplomatique et des voies juridiques pour parvenir à une paix durable. L’histoire de 1975 est fondamentale pour comprendre les enjeux contemporains et les responsabilités des acteurs régionaux et internationaux.


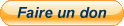













Commentaires