BOUALEM SANSAL, UNE GRÂCE PRÉSIDENTIELLE OU UN AVEU D’IMPUISSANCE ?
- Brahim Al Maghribi

- 12 nov. 2025
- 4 min de lecture

Le régime algérien s’est une nouvelle fois pris à son propre piège. Après avoir exhibé Boualem Sansal comme l’incarnation de la “trahison nationale”, l’appareil d’Alger s’est retrouvé incapable d’assumer jusqu’au bout son propre scénario. Condamné en mars 2025 à cinq ans de prison pour “atteinte à l’unité nationale”, l’écrivain de 76 ans, affaibli par la maladie et reconnu à l’international comme l’une des grandes voix francophones de la liberté d’expression, a quitté l’Algérie le 10 novembre 2025 à bord d’un avion militaire allemand (vol GAF630) direction Berlin.
Ce départ, présenté par les médias d’État comme un “geste humanitaire” du président Abdelmadjid Tebboune en réponse à une “demande fraternelle du président allemand”, n’est en réalité qu’une mise en scène soigneusement orchestrée pour masquer un embarras monumental. Le régime algérien, obsédé par l’image, s’est enfermé dans un double discours : d’un côté, il voulait paraître intransigeant face à ce qu’il qualifie de “menaces étrangères” ; de l’autre, il cherchait une porte de sortie pour se débarrasser d’un prisonnier devenu politiquement explosif.
Boualem Sansal n’était pas seulement un écrivain dissident : il était devenu un “objet encombrant”, symbole vivant des contradictions d’un pouvoir qui s’enferme dans ses propres postures. Durant plusieurs mois, Alger a utilisé son cas pour alimenter un sentiment anti-français, surfer sur la colère populaire, et renforcer le mythe d’une Algérie “attaquée de toutes parts”. Mais à mesure que le temps passait, le discours s’est fissuré. Car le monde entier savait que Sansal, vieil homme malade, était détenu pour ses opinions, un fardeau moral et diplomatique dont l’Algérie ne savait plus comment se délester.
C’est là qu’intervient Berlin. Les autorités allemandes, soucieuses de préserver leurs relations avec Alger mais aussi de défendre les droits fondamentaux, ont adressé une note diplomatique ferme, soulignant “l’urgence humanitaire” et la nécessité de permettre à Sansal de recevoir des soins adaptés. Pour Tebboune, soigné lui-même en Allemagne durant la pandémie de Covid-19, il aurait été indécent de refuser. Alors, le régime a préféré travestir sa reculade en un geste “humanitaire” de souveraineté.
Lire aussi : Boualem Sansal, symbole de la répression en Algérie
Mais en réalité, cette libération soudaine de Boualem Sansal, annoncée le 12 novembre 2025, n’a rien d’un geste humanitaire improvisé. Elle survient après plusieurs pressions diplomatiques, notamment de la part de l’Allemagne, où Sansal devrait bientôt se faire soigner et dont le président Frank-Walter Steinmeier avait, le 10 novembre 2025, appelé publiquement Alger à libérer l’écrivain. Tebboune s’est exécuté, et cette grâce, arrachée sous contrainte internationale, tombe également juste après une victoire stratégique du Maroc, marquée par la montée en puissance du plan d’autonomie pour le Sahara. Coïncidence ? Certainement pas.
Depuis l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, le vent tourne clairement en faveur de Rabat. Le plan d’autonomie marocain, autrefois discuté, est désormais reconnu comme la base réaliste pour une solution durable. Les soutiens s’accumulent : États-Unis, Espagne, France, Royaume-Uni, pays du Golfe, Union africaine. À l’inverse, l’Algérie, prisonnière d’une posture rigide et incapable d’adaptation, voit son crédit diplomatique s’éroder à chaque session onusienne. Sa politique du refus permanent a fini par l’isoler.
Dans ce contexte, la libération de Sansal n’est pas un signe de grandeur, mais un geste défensif, un calcul d’image. Alger tente d’adoucir son profil au moment où les chancelleries occidentales ferment une à une la porte à son discours sur le Sahara. Le pouvoir libère un intellectuel pour paraître magnanime, alors même qu’il cède sous la pression combinée de l’opinion internationale et de la réussite marocaine. Le contraste est saisissant : pendant que Rabat étend son influence, l’Algérie s’enferme dans la censure et l’intimidation. L’un consolide ses alliances, l’autre les perd ; et au milieu, Sansal devient malgré lui le symbole d’un régime contraint d’obéir à la réalité qu’il niait : le Maroc gagne la bataille du terrain, du droit et du respect.
Cette libération, présentée par Alger comme un acte de clémence, ressemble surtout à une reddition diplomatique. Quand un pays en quête de crédibilité relâche un écrivain pour apaiser Berlin pendant que Rabat engrange les soutiens internationaux, la hiérarchie régionale est claire. Sansal retrouve la liberté, mais c’est Rabat qui sort grandi. Alger a libéré un homme, Rabat a libéré la parole et l’avenir.
Car, en vérité, cette opération n’a rien d’humanitaire : elle est purement politique. Alger cherche à sauver la face, à donner le change à une opinion publique chauffée à blanc par des années de propagande, et à convaincre le monde qu’elle agit “par grandeur morale”. Mais la réalité est plus crue : le régime a flanché.
L’affaire Sansal révèle la pathologie profonde d’un pouvoir enfermé dans la peur : peur du débat, peur de la critique, peur de perdre le contrôle du récit national. En condamnant un écrivain pour des mots, le régime a voulu affirmer sa force ; en le libérant sous pression étrangère, il en a démontré la faiblesse.
Psychologiquement, ce pouvoir vit dans une logique de projection et de fuite. Il diabolise l’autre, la France, le Maroc, les intellectuels, pour masquer ses propres fractures internes. Il s’invente des ennemis pour éviter de regarder en face la faillite politique, économique et morale d’un système qui tourne à vide. Il accuse, menace, se déchaîne, puis recule, incapable de supporter les conséquences de sa propre hystérie.
Le cas Sansal restera comme une parabole : celle d’un régime qui emprisonne la pensée, mais finit toujours par être prisonnier de ses mensonges.


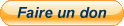



Salam aleykoum, bravo à vous. Vous faites un très beau travail. La réalité rattrape le régime.