L'HISTOIRE DE RABAT-SALÉ
- 8 févr.
- 5 min de lecture

Classée patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, fourmillant de projets, Rabat est une capitale centenaire en pleine forme. Forte de ses nombreux espaces verts, de son patrimoine historique formidablement bien conservé, de son urbanisme maîtrisé et du civisme tranquille de ses habitants, la ville a récemment entamé sa mue. Au programme: la diversification de ses activités et donc, de sa population, la rénovation des quartiers défavorisés et surtout, la valorisation de ses innombrables atouts culturels et touristiques. Rabat la secrète, la mal-aimée, entreprend en effet de faire partager son patrimoine, désormais consacré par l'Unesco, au reste du Maroc et du monde.

De l'autre côté du Bouregreg, la ville jumelle de Salé a connu, elle, un destin contrarié. Celle qui fut longtemps un phare culturel et spirituel rayonnant dans tout le royaume, s'est éteinte au fil des siècles. Aujourd'hui ville-dortoir minée par la pauvreté et la surpopulation, elle se cherche un avenir. Celui-ci passera, on l'espère, par le projet Bouregreg dont l'un des objectifs premiers est de réconcilier ces deux cités et de leur faire retrouver le chemin d'un destin commun.

C'est cette histoire que nous livrons dans les pages qui suivent: le récit de l'arrivée des Andalous chassés par l'Inquisition, qui a donné à la ville son visage si particulier, la légende des corsaires de Salé, mais aussi et surtout, cette histoire telle qu'elle perdure à travers ses quartiers, ses monuments, ses maisons, ses jardins et ses coutumes. Pour la raconter, nous avons emprunté les souvenirs de R'batis et de Slaouis de souche, qui nous ont parlé de leur ville respective à travers leur propre itinéraire. Ce dossier n'a donc aucune prétention scientifique car il est le fruit de Souvenirs, forcément subjectifs. Mais leurs confidences dressent, mieux que tous les livres d'histoire, le portrait terriblement attachant de ces deux villes. Car, sous leur réserve de façade, les R'batis comme les Slaouis vouent une véritable passion à leur cité respective. Et c'est l'un des enseignements les plus frappants de dossier.

Ce n'est qu'à l'orée du XXème siècle que le Maroc se dote d'une capitale administrative pour ancrer définitivement son passage d'une forme d'Etat féodal à celle d'un Etat moderne au sens jacobin du terme. Rabat sera cette capitale. La question de la légitimité de ce choix se pose. En effet, cette ville n'a pas été, historiquement, la favorite des empires successifs, comparée à Fès, Marrakech ou Meknès. Pourtant, cette décision qui pourrait passer pour incongrue se révèle, à l'étude, loin d'être fortuite. D'abord, il y a la volonté opportuniste de la France d'éloigner le jeune Sultan Ben Youssef menaçant grève du sceau de Fès, sa capitale et lieu de résidence de ses conseillers. Ensuite, Rabat, au même titre que sa ville jumelle, Salé (jusqu'au XIXe siècle, Rabat a d'ailleurs pour nom Salé-le-Neuf), bénéficie d'une situation géographique et topographique stratégique et unique du fait de sa situation à l'estuaire du Bouregreg sur le littoral atlantique. Riche en eau, en faune et flore et disposant d'un climat tempéré, la région est habitée depuis l'aube des temps. Le docteur Mohammed Es-Semmar, de la direction du département du patrimoine de l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bouregreg, rappelle ainsi que Rabat, ville maritime et cité fluviale, à la fois antique et islamique, regorge de monuments historiques et de vestiges archéologiques qui, comme le prouvent les grottes de Dar Sultan, les grottes de Harhoura et les grottes de Contrebandier font remonter les premières installations humaines à 160.000 ans. Sur les berges gauche et droite de l'estuaire du Bouregreg se sont succédés les Amazigh, les Phéniciens, les Carthaginois et surtout les Romains qui transformeront cet ancien comptoir antique en ville romaine, capitale sud de la Mauritanie Tinginate qu'ils dénommeront Sala ou Sala Colonia (du proto-berbère, Challa, le rocher).
En 1150, les Almohades édifient sur la rive gauche du Bouregreg une citadelle (actuelle Kasbah des Oudayas), une mosquée et une résidence. Sous le règne du sultan saâdien Yacoub al- Mansour, le lieu est nommée Ribat Al Fath (poste de la conquête) pour mieux signifier son emplacement stratégique comme point de rassemblement aux expéditions almohades en Andalousie. Yacoub al-Mansour, dit encore Al Dhahabî (le doré ou l'aurifère) en raison de sa richesse colossale, marquera de son sceau l'histoire du Maroc dont il se rendra maître, ainsi que d'une partie de l'Afrique de l'Ouest. Dans une étude récente sur les origines de la monarchie marocaine de l'historien Nabil Mouline, on apprend que sous son règne, Yacoub al-Mansour entreprend, pour légitimer son pouvoir à l'intérieur du Maroc, de transcender le cadre tribal en s'affirmant comme autorité religieuse et en manifestant une volonté centralisatrice. A quoi s'ajoute une politique extérieure soucieuse d'échapper à l'influence étrangère, notamment ottomane, et visant à étendre son empire sur le Sahara et le Soudan. C'est donc Yacoub al-Mansour qui instaure l'Etat Makhzen avec, entres autres signes d'allégeance, la cérémonie de la Baïa'a qui apparaît pour la première fois sous son règne. Il fait aussi de l'intégrité territoriale son cheval de bataille. Les constantes de ce souverain ayant régné au XIIème siècle seront reprises par toutes les dynasties qui lui succéderont.
A l'apogée de son règne, Yacoub al-Mansour entreprend d'édifier à Ribat el Fath une « Alexandrie de l'Atlantique ». Il érige la Tour Hassan à l'image de la Koutoubia de Marrakech et de la Giralda de Séville. Une tour qui devait constituer le minaret d'une des plus grandes mosquées au monde pouvant contenir une armée entière. Il fortifie également la Kasbah et l'entoure de deux immenses murailles percées de cinq portes. Mais Yacoub al- Mansour meurt sans avoir achevé son œuvre et la ville perd alors de son éclat. La plus grande mosquée du monde, la Tour Hassan, ne sera jamais terminée et tombera peu à peu en ruines.
La fin de la dynastie Almohade amorcera le déclin de Ribat Al Fath. Néanmoins cette ville, capitale de l'empire Almohade, port d'embarquement des troupes vers l'Andalousie, Alexandrie rêvée d'un puissant sultan qui se ruina à la construire, aura, à la faveur des tumultes de l'histoire, un autre destin que celui qui devait être le sien. Un destin andalou. En effet, en 1492, à la chute de Grenade, dernier bastion de ce qui fut l'empire arabo-andalou, et alors que Salé-le-Neuf n'est plus depuis longtemps qu'un hameau abritant quelques centaines de maisons, comparée à Salé-le-Vieux, premier port commercial du Royaume de Fès, la ville devient l'un des points de chute principaux de plusieurs milliers de réfugiés andalous chassés par les édits d'expulsion successifs émis par les Rois catholiques d'Espagne lancés dans une rageuse reconquête inquisitrice. Persécutés, astreints à porter le signe du croissant jaune en marque d'infamie cousu sur leur chapeau, spolies, victimes de pogroms, jetés à la mer, les musulmans et les juifs d'Andalousie fuient par vagues successives la terre de leurs ancêtres. Certains, comme les habitants de la ville de Homachos, au nombre de 5.000 environ et formant un groupe homogène, constitueront la première vague qui emportera avec elle biens, fortunes et caveaux familiaux. A leur arrivée, ils s'installent à la Kasbah des Oudayas qu'ils renforcent militairement et reconstruisent en y imprégnant un fort cachet andalou.

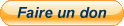








Commentaires